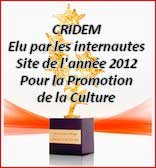02-05-2025 14:30 - Répression des étudiants, mais où sont les enseignants? Par Pr. ELY Mustapha

Pr. ELY Mustapha -- Dans la défense des idéaux de démocratie et de liberté, que son maitre lui a enseignés, fallait-il que l’élève ait plus de courage que son maitre ?
Et si cela devait être, alors dans une éthique démocratique, et de savoir libéré, le maitre serait-il toujours celui que l’on croit ?
Dans l’éducation, la Praxis du savoir , est bien sœur de son Axis. « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle » (Kant)
Les étudiants mauritaniens subissent une répression systématique depuis des décennies, marquée par des violences policières, des restrictions des libertés syndicales et une militarisation des campus.
Cette dynamique, loin de résoudre les tensions, nourrit un cycle de méfiance et de radicalisation qui hypothèque l’avenir du pays. Une répression qui dure et un corps enseignant muet. Pas une dénonciation, pas un manifeste.
I- Contexte historique : une tradition répressive ancrée
La répression des mouvements étudiants en Mauritanie ne date pas d’hier. Dès février 1966, des forces armées réprimaient des manifestations d’étudiants noirs à Nouakchott, inaugurant une ère de contrôle autoritaire des campus. Dans les années 1980-1990, le régime d’Ould Taya a intensifié la persécution des étudiants issus des communautés négro-africaines, combinant expulsions massives, tortures et exécutions extrajudiciaires
. Ces pratiques ont créé un terreau de défiance durable entre l’État et la jeunesse éduquée.
Une escalade répressive récurrente (2018-2025)
Les cinq dernières années confirment la persistance de méthodes brutales :
• Février 2018 : dispersion violente d’une manifestation étudiante à l’université de Nouakchott par des forces policières
• Février 2024 : la Coalition Espoir Mauritanie dénonce des « violences policières graves » contre des étudiants réclamant une révision des critères de bourses et le maintien de l’aide sociale. L’Union nationale des étudiants qualifie alors la répression de « politique d’État »
• Avril 2025 : double intervention musclée les 11 et 18 avril devant le ministère de l’Enseignement supérieur, avec usage de force contre des manifestants exigeant des élections syndicales libres et des réformes académiques. Des vidéos montrent des blessés parmi les étudiants.
Revendications légitimes, réponses sécuritaires
Les doléances étudiantes restent inchangées depuis des années :
1. Justice sociale : révision des critères d’attribution des bourses jugés discriminatoires et rétablissement de l’aide sociale.
2. Démocratie universitaire : organisation d’élections libres pour la représentation étudiante, suspendues en février 2025 après des actes de vandalisme attribués à des factions rivales. 3. Modernisation : mise à jour des programmes académiques et amélioration des infrastructures
Pourtant, le ministère privilégie systématiquement la réponse sécuritaire. En février 2025, il suspend les élections étudiantes suite à des incidents, plutôt que d’enquêter sur leurs causes profondes. En avril 2025, il fait disperser des sit-in pacifiques, alimentant un climat de défiance.
Les conséquences d’une stratégie contre-productive
Cette approche répressive engendre trois effets pervers :
• Radicalisation des mouvements : l’Union nationale des étudiants menace désormais de « mesures d’escalade » face au blocage politique.
• Perte de légitimité : les expulsions disciplinaires de leaders étudiants, réalisées sans représentation étudiante au conseil de discipline, discréditent les institutions.
• Internationalisation des critiques : des organismes comme la Coalition Espoir Mauritanie et des ONG internationales relaient désormais ces abris, nuisant à l’image du pays.
Pour une alternative démocratique
L’histoire montre que la violence d’État ne résout pas les crises universitaires – elle les aggrave. En 1994 déjà, Human Rights Watch documentait comment la répression des étudiants noirs avait exacerbé les tensions ethniques. Aujourd’hui, la militarisation des campus risque de reproduire ces erreurs.
Une solution durable exige:
• Un dialogue inclusif avec l’ensemble des syndicats étudiants, sans exclusion préalable.
• La reconstitution d’instances représentatives via des élections libres et sécurisées.
• Une commission indépendante pour enquêter sur les violences policières récurrentes.
Les étudiants ne sont pas l’ennemi intérieur, mais les architectes du futur mauritanien. Continuer à les réprimer, c’est sacrifier la stabilité à long terme du pays sur l’autel d’un ordre autoritaire éphémère. Comme le soulignait déjà l’Union nationale des étudiants en 2024 : « Les solutions de répression ne sont pas la solution ». Il est temps que le pouvoir l’entende.
II- Mais où sont face à cette répression de leurs disciples, les maitres ?
La question de la discrétion du corps professoral mauritanien face à la répression étudiante révèle une complexité institutionnelle et historique, où plusieurs facteurs structurels et politiques se conjuguent pour expliquer ce silence apparent.
Les enseignants constituent la première ligne de défense contre la violence et la répression estudiantine, tant par devoir éthique que par responsabilité institutionnelle. Cette obligation s’enracine dans plusieurs dimensions clés, éclairées par les normes internationales et les réalités éducatives.
1. Mandat légal et éthique incontournable
Les cadres internationaux soulignent trois rôle impératifs dévolus aux enseignants :
• Devoir de protection : Les enseignants ont l’obligation légale d’« anticiper les dangers » et de garantir l’intégrité physique et psychologique des élèves, y compris face aux violences institutionnelles.
• Rôle de sentinelle : Leur position frontalière en fait des observateurs privilégiés capables de repérer précocement les signes de répression et d’orienter les victimes vers des dispositifs d’aide.
• Exemplarité démocratique : En incarnant des relations respectueuses, ils modèlent des comportements non violents et promeuvent la résolution pacifique des conflits.
L’inaction des enseignants aggrave les crises :
• Radicalisation : Privés de médiateurs académiques, les étudiants optent pour des modes d’action violents (grèves, affrontements).
• Désertion intellectuelle : La fuite des cerveaux vers des universités étrangères s’accélère, appauvrissant le capital humain national..
• Cicatrisation impossible : Les blessures physiques (ex. : interventions d’avril 2025) et psychologiques (traumatismes post-répression) hypothèquent l’avenir académique.
2. Un corps enseignant fragilisé et précaire
Le système universitaire mauritanien souffre d’une précarisation massive des enseignants : plus de 60 % du personnel académique sont des vacataires, soumis à des contrats temporaires et privés de sécurité de l’emploi. Cette précarité rend les professeurs vulnérables aux pressions politiques, les dissuadant de s’engager publiquement pour soutenir les étudiants. « Intervenir signifierait la fin de notre contrat ».
Une autonomie universitaire illusoire
Les instances disciplinaires, comme le Conseil de discipline de l’Université de Nouakchott, excluent systématiquement les représentants étudiants de leurs délibérations3. Cette marginalisation des voix critiques s’étend au corps enseignant, dont l’absence dans les processus décisionnels illustre un contrôle étatique strict. En février 2025, la suspension unilatérale des élections étudiantes par le ministère, sans consultation des académiciens, confirme cette logique autoritaire.
La crainte des représailles et l’autocensure
L’historique répressif du régime – expulsion d’étudiants, tortures policières (2018-2025) – crée un climat de terreur institutionnalisée. Les professeurs titulaires eux-mêmes évitent de s’exposer, craignant des mesures disciplinaires ou des mutations arbitraires. En avril 2025, l’expulsion de leaders étudiants « pour actes de vandalisme », sans preuves tangibles, rappelle les risques de toute solidarité affichée.
Une crise de légitimité systémique
Seuls 12 % des enseignants du supérieur ont un doctorat, accentuant la dépendance aux directives ministérielles. Cette faiblesse académique, couplée à des programmes obsolètes, mine la capacité des professeurs à incarner une autorité intellectuelle indépendante.
L’alternative silencieuse : résistances informelles
Certains universitaires agissent en coulisses, fournissant un soutien logistique ou juridique aux étudiants persécutés. Cependant, ces actions discrètes, non médiatisées, restent invisibles face à la machine répressive.
En définitive, le mutisme relatif du corps professoral ne reflète pas une complicité, mais une stratégie de survie dans un système où l’autonomie universitaire est un leurre. Tant que persistera la militarisation des campus et la précarisation des enseignants, l’université mauritanienne restera une citadelle assiégée, incapable de remplir sa mission émancipatrice.
Et il n’est point demandé au corps enseignant, de répondre à la violence par la violence (il sortirait alors de son rôle d’exemple), mais d’agir pacifiquement, de dénoncer, de mettre sa parole, renforcée par sa crédibilité au service la liberté, de la démocratie. Et dire, haut-et-fort, ce qui, humainement, devrait être par rapport à ce qui, misérablement, est.
La parole est le glaive de ceux qui savent, contre la répression et l’injustice des ignorants.
Voies de réforme urgentes
Pour restaurer le rôle protecteur et conciliateur des enseignants, des mesures concrètes s’imposent
• Sécurisation des statuts : Convertir les contrats précaires en postes titulaires pour libérer la parole.
• Formation obligatoire : Intégrer des modules sur la médiation conflictuelle et les droits humains dans les curricula pédagogiques.
• Protocoles clairs : Établir des procédures anti-répression validées par des instances indépendantes (ONG, syndicats).
Comme le rappelle l’UNESCO, « les enseignants sont les architectes d’écosystèmes éducatifs résilients ». En Mauritanie, leur réhabilitation comme remparts contre la violence n’est pas optionnelle – c’est une condition sine qua non pour reconstruire une université au service de l’émancipation collective.
L'impératif de la moralité est inconditionnel, absolu, catégorique, universel. Kant énumère trois impératifs catégoriques dans la Critique de la raison pratique :
« Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle ; agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen ; agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la république des volontés libres et raisonnables. »
Ce que déjà le prophète Mohamed (PSL) résumait dans un célèbre hadith : « « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il ne souhaite pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. » (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).
Notre prophète (PSL) avait déjà érigé les valeurs humaines en « loi universelle » : "Quiconque d'entre vous voit quelque chose de blâmable, qu’il le change de sa main ; s'il ne peut pas, alors avec sa langue ; et s'il ne peut pas, alors avec son cœur ; et c'est là le plus faible niveau de la foi !" (Hadith du Prophète Mohamed, Paix éternelle soit sur lui)
Le regard du maître prolonge en quelque sorte celui du Prophète sur ses Compagnons, qui a pour source le regard de Dieu sur Sa création : « Heureux ceux qui m’ont vu, et heureux ceux qui ont vu ceux qui m’ont vu. »
Mais les étudiants d’aujourd’hui ressentent-ils le regard, fut-il empathique, de leurs maitres ?
Pr ELY Mustapha