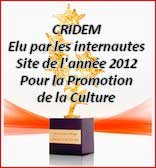01-10-2025 19:12 - Cadrage de la gouvernance en Mauritanie : clarifier les rôles, renforcer l’État

LE RÉNOVATEUR QUOTIDIEN -
La gouvernance de l’État mauritanien repose sur une architecture constitutionnelle relativement claire : le Président de la République incarne la souveraineté nationale, fixe les grandes orientations en matière de diplomatie, de défense et de sécurité, et nomme le Premier ministre, qui dirige l’action du gouvernement.
À ce binôme s’ajoutent les ministres, chacun chargé de piloter les politiques publiques de son secteur. En théorie, l’équilibre des pouvoirs au sein de l’exécutif est conçu pour articuler stratégie, coordination et mise en œuvre.
Mais dans la réalité administrative et politique, cette organisation rencontre des limites structurelles qui fragilisent l’efficacité de l’action publique et obscurcissent la lisibilité institutionnelle pour les citoyens.
La centralisation des leviers de pouvoir au niveau de la Présidence est l’un des traits dominants du fonctionnement actuel. De nombreux organes de régulation, de contrôle ou de gouvernance — censés fonctionner de manière autonome — sont rattachés directement ou indirectement à la Présidence.
Ce modèle, hérité d’une tradition de gouvernance présidentielle forte, pose aujourd’hui la question de l’équilibre des pouvoirs et de la neutralité des institutions. Si la légitimité du chef de l’État n’est pas en cause, il devient néanmoins nécessaire de clarifier les rôles fonctionnels des autres pôles de gouvernance, notamment la Primature et les ministères, afin d’éviter toute confusion dans la chaîne de décision.
La Primature, en particulier, est appelée à jouer un rôle central dans la coordination et la cohérence de l’action gouvernementale. Le Premier ministre, chef de gouvernement par essence, doit être doté non seulement de responsabilités claires, mais également de moyens institutionnels et opérationnels pour les exercer.
Or, la pratique montre une fonction parfois réduite à un simple rôle administratif ou de relais, sans réel pouvoir d’arbitrage ni autonomie stratégique. Ce déséquilibre fragilise l’impulsion politique des réformes, ralentit l’exécution des politiques transversales et brouille la responsabilité collective du gouvernement.
Au sein des ministères, le fonctionnement reste largement sectorialisé. Les départements agissent souvent de manière autonome, voire cloisonnée, sans coordination réelle ni culture partagée de la performance. Cela nuit à la mise en œuvre de politiques publiques intégrées, à l’efficacité des services rendus aux citoyens et à la capacité de l’État à répondre aux défis complexes — qu’ils soient sociaux, économiques ou environnementaux.
L’absence d’un dispositif formel de coordination intersectorielle empêche par ailleurs toute harmonisation des priorités, toute mutualisation des ressources et toute évaluation objective des résultats.
Ce manque de clarté fonctionnelle a pour effet de diluer la responsabilité et de nuire à la redevabilité. Le citoyen, souvent confronté à des institutions opaques, ne sait plus exactement qui décide, qui exécute, et qui doit rendre compte.
Ce brouillard institutionnel entretient une distance entre l’État et la société, et alimente la méfiance envers l’administration. Une réforme du cadre de gouvernance ne peut dès lors se limiter à des ajustements techniques : elle doit rétablir une hiérarchie lisible des responsabilités, clarifier les compétences de chaque échelon exécutif et rendre visibles les mécanismes de contrôle.
Concrètement, une série de mesures s’impose : adopter un décret ou un texte réglementaire formalisant la répartition des prérogatives entre la Présidence, la Primature et les ministères ; renforcer le rôle institutionnel du Premier ministre dans l’élaboration, la coordination et l’évaluation des politiques publiques ; garantir l’indépendance des organes de régulation à travers des statuts clairs, un financement autonome et des mécanismes de reddition de comptes ; et mettre en place une plateforme nationale d’information et de suivi de l’action gouvernementale accessible au public.
Plus largement, il s’agit de promouvoir une culture de gouvernance fondée sur la responsabilité partagée, la transparence et la performance. Dans un contexte où les attentes sociales évoluent et où les ressources publiques doivent être mieux mobilisées, l’État mauritanien a intérêt à se doter d’un appareil exécutif plus lisible, plus coordonné et plus réactif. Cela passe par une volonté politique affirmée, mais aussi par une réforme administrative structurée, inscrite dans la durée.
Clarifier les rôles n’est pas un simple exercice juridique. C’est une condition de l’efficacité de l’État et de la confiance citoyenne. La Constitution fournit le socle. À l’État revient la responsabilité de bâtir une gouvernance moderne, fonctionnelle et au service de tous.