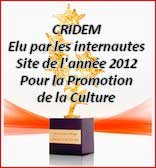03-05-2025 23:09 - Liberté de la presse : Les journalistes payent-ils pour l’activisme sur les réseaux sociaux?

La Dépêche -
La Mauritanie connait un recul dans la liberté de presse et d’expression. Le constat évident est perceptible dans le dernier classement de RSF 2025 sur la liberté des médias dans le monde qui recale notre pays de la de 33ème à 50ème place. Triste constat après avoir servi de “bon” exemple dans notre aire arabe et africaine. Pourquoi ?
Le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse est souvent l’arrêt qu’on observe pour mesurer le chemin parcouru. Les acquis mais aussi les défis qui souvent se dressent devant l’accomplissement professionnel, contre « leur crédibilité et leur diversité » comme veulent l’imprimer les NU aujourd’hui avec l’intrusion de la technologie de l’Intelligence Artificielle (IA).
La journée est aussi l’opportunité d’une ode à tous les militants de la liberté et de l’émancipation humaines qui ont marqué de leur vivant le combat toujours en cours pour la liberté de la parole dans notre société. De Coulibaly Souleimane, à Mohamed Fall Oumeir, en passant par Habib Ould Mahfoudh ou encore Moussa Diop, et tous les autres confrères qui ont rendu l’âme, convaincus des idéaux qu’ils portaient contre le bâillonnement de la liberté, c’est toujours l’occasion d’une pensée émue en cette journée si particulière.
C’est aussi l’endroit de se souvenir de plus de 200 journalistes palestiniens massacrés par Israël ; sans oublier évidemment les médias occidentaux fervents défenseurs de l’ignominie et de la rétention délibérée de l’information.
Les choses ont-elles véritablement changé chez nous depuis lors ? Oui, des améliorations sont notoires mais beaucoup de « manigances » liberticides persistent encore. L’espoir est surtout fondé sur la volonté affichée par le premier magistrat du pays mais aussi sur le rappel de confrères dans l’appareil gouvernemental (tutelle et régulation) pour aider à mieux cerner la dialectique des médias.
Si l’on peut aussi admettre, sans fléchir, l’anarchie qui caractérise le secteur, le déficit de formation et la ruée des intrus, la confusion fatale dans le cadre légal et règlementaire aggrave et réduit le rôle des médias traditionnels noyés dans le tsunami numérique des réseaux sociaux. A telle enseigne que les médias et les journalistes semblent aujourd’hui, en pratique, payer à travers la loi pour les dépassements observés sur les réseaux sociaux.
La difficulté inhérente à la confusion de genres ne permet pas, dans beaucoup d’esprits peu éclairés, de poser un marqueur sur la frontière entre les différentes sources d’information. Loin s’en faut. Les pouvoirs publics, non plus, ne font pas, en raison de l’audience spectaculaire des réseaux sociaux, la distinction entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux.
Entre journalistes qui observent leur responsabilité sociale et les activistes de la toile qui vivent de la provocation. D’où les interférences entre les champs d’application de la loi sur la liberté de presse et la loi sur la cybercriminalité comme le font indistinctement d’ailleurs les lois sur les symboles de 2021 et celle de la lutte contre la cybercriminalité, devenue un fourre-tout au nom de la «protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l’autorité de l’État et à l’honneur du citoyen ».
Une épée de Damoclès suspendue sur la tête du journaliste pour caractériser les abus causés par les réseaux sociaux. Une confusion fatale pour la liberté que le Gouvernement gagnerait à réviser pour rester en phase avec le désir du président qui dans son dernier message à l’occasion de cette journée internationale de la presse réitérait : « Nous réaffirmons la poursuite des efforts visant à la professionnaliser et à la développer, convaincus de l’importance de son rôle pionnier dans la formation de la conscience sociétale et l’éveil de l’opinion publique”.
Une promesse que souligne ce jour, le ministre de tutelle, Houssein Ould meddou, martelant que « le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a fait du renforcement de la liberté de la presse et de l’amélioration des conditions d’exercice de la profession de journaliste un pilier fondamental de son projet national ». Alors wait and see.
JD