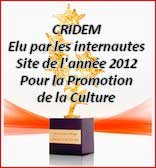14-09-2025 13:30 - Le Sahel à l’épreuve des interdits universels, entre chaos normatif et souverainisme fragile

« Les interdits fondateurs ne sont pas des dogmes, mais des horizons évolutifs », rappelait Mireille Delmas-Marty. Meurtres de masse, esclavage sexuel, destructions de biens culturels, enrôlement d’enfants, ces atrocités qui devraient relever des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité continuent de se multiplier au Sahel.
À Kayes, dans l’ouest malien, des habitants décrivent l’installation de checkpoints par des groupes armés affiliés au JNIM, l’imposition de taxes aux éleveurs, l’interdiction faite aux femmes de circuler librement et des exécutions sommaires de ceux qui refusent d’obéir. Ces pratiques, banales dans leur répétition, traduisent une substitution rampante de l’autorité étatique par une violence normative privée.
Aux exactions commises par les groupes djihadistes s’ajoutent celles, documentées, parfois imputées aux armées régulières. Dans ce brouillard de violences une constante demeure, ce sont les civils qui paient le prix le plus lourd.
Le prisme juridique occulté
Le droit international offre pourtant des outils. Le Mali est partie au Statut de Rome depuis 2000 et a saisi la Cour pénale internationale en 2012. L’attaque systématique de populations civiles par des groupes armés non-étatiques, le recrutement d’enfants soldats, les exécutions sommaires ou les actes d’esclavage tombent directement sous les articles 7 et 8 du Statut.
De même, l’extorsion et l’administration parallèle imposée par la violence relèvent des interdits de pillage et de coercition prohibés par le droit humanitaire (Conventions de Genève de 1949 et Protocole additionnel II).
Pourtant, ces qualifications restent rarement discutées sur le continent. Les analystes se tournent vers les paradigmes de la sécurité et de la géopolitique, laissant en jachère le levier juridique.
L’épreuve malienne des interdits fondateurs
Depuis plus d’une décennie, le Mali vit une succession de violations massives, villages rasés, minorités religieuses persécutées, enfants recrutés de force, écoles détruites. Ces faits ne sont pas seulement des tragédies humaines, ce sont des atteintes aux interdits fondateurs de l’humanité.
La CPI a ouvert plusieurs enquêtes, dont celle qui a mené à la condamnation d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi en 2016 pour la destruction des mausolées de Tombouctou, première jurisprudence internationale sur la protection du patrimoine culturel. Plus récemment, en 2024, la Cour a condamné Al Hassan pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans la même ville. Mais ces poursuites, limitées et lentes, peinent à refléter l’ampleur des crimes.
Le contraste est criant, des interdits universels proclamés mais une incapacité structurelle à les traduire en justice effective, nationale ou internationale.
L’impasse des instruments régionaux
L’Afrique avait tenté de se doter de ses propres mécanismes, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), la Cour africaine des droits de l’homme (2004), ou la CEDEAO avec sa dimension judiciaire.
Mais leurs effets restent fragiles. À Kayes, malgré des violations graves et répétées, les instances régionales n’ont produit aucune réaction notable. Les arrêts de la Cour de Justice de la CEDEAO, déjà peu respectés, deviennent encore plus fragiles depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont acté leur retrait de l’organisation en 2025. La Cour africaine, quant à elle, reste limitée par le refus de plusieurs États d’accepter sa compétence obligatoire.
Résultat, les instruments existent mais leur légitimité et leur effectivité sont en crise.
Le piège du souverainisme fragile
À cette crise normative s’ajoute un discours souverainiste revendiqué par les États sahéliens. Rejet des interventions étrangères, dénonciation des ingérences occidentales, le vocabulaire du souverainisme est devenu récurrent.
Mais ce souverainisme repose sur des bases fragiles. Comment revendiquer une autonomie pleine lorsque la justice nationale est dysfonctionnelle, que l’armée peine à protéger les civils et que l’administration chancelle. Comment parler de souveraineté quand des groupes armés organisent leur propre fiscalité et leur propre justice dans des villages entiers. Ce souverainisme proclamé devient alors un souverainisme de façade, masque politique d’un État sans socle juridique ni institutionnel capable de garantir la dignité de ses citoyens.
Delmas-Marty nous a appris à ne pas figer le droit dans des fondations rigides mais à le penser comme une construction évolutive. Le Mali et, au-delà, le Sahel posent une énigme, comment concilier l’universalité proclamée des interdits fondateurs avec leur trahison quotidienne sur le terrain.
La réponse ne viendra ni de l’incantation souverainiste ni des proclamations abstraites d’un universalisme hors-sol. Elle viendra d’un effort commun, africain et universel, pour transformer le chaos sahélien en opportunité de refonder l’universalité des droits.
Non plus comme un dogme imposé mais comme une valeur construite par ceux qui, dans les villages et les villes du Sahel, refusent que la dignité humaine soit sacrifiée.
Par Mansour LY
Juriste -consultant en droit international