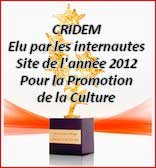06-07-2025 21:00 - Dialogue national : outil de réforme ou ballon de ping-pong politique ?

(LE RÉNOVATEUR QUOTIDIEN) -
Le lancement du dialogue national, au début du second mandat du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, suscite autant d’attentes que de doutes.
Officiellement, cette initiative vise à « renforcer la cohésion sociale », « traiter les dossiers sensibles » et « faire progresser la démocratie ». Mais derrière cette façade consensuelle, beaucoup s’interrogent sur les motivations réelles du régime.
À l’analyse, le timing, le contexte politique et les dynamiques de participation laissent penser que ce dialogue pourrait aussi bien servir de levier de réforme que de stratégie de diversion politique.
Un timing habilement calculé
L’offre de dialogue intervient à un moment politiquement opportun : le début du second et dernier mandat présidentiel. Cette période, traditionnellement libérée des pressions électorales, est propice à des réformes ambitieuses. Mais elle offre aussi un terrain favorable aux manœuvres de consolidation du pouvoir. En lançant un processus potentiellement long et complexe, le régime peut occuper l’espace politique, gagner du temps et diluer les tensions, tout en maintenant un contrôle étroit sur le rythme et les contours des débats.
Un climat politique sous pression
La situation politique et sociale du pays est marquée par une montée des tensions : revendications sur le passif humanitaire, accusations d’inégalités persistantes, sentiment d’impunité, perception d’une corruption endémique. Dans ce contexte, le dialogue apparaît comme une soupape de décompression, un moyen de canaliser les mécontentements dans un cadre institutionnalisé. Mais faute d’agenda clair et de garanties sur la prise en compte des doléances, l’initiative pourrait être perçue comme une manière d’éviter les réponses concrètes aux urgences nationales.
Une opposition fragmentée : entre adhésion prudente et boycott assumé
Certains partis de l’opposition, notamment l’UFP et Tawassoul, ont choisi de participer au dialogue. Leur présence pourrait conférer une légitimité minimale au processus. Toutefois, leur engagement reste conditionné à la transparence et à l’inclusivité réelle des discussions. Ces formations politiques avancent prudemment, conscientes des risques de récupération politique.
À l’inverse, plusieurs partis et coalitions issus des communautés négro-africaines posent des préalables fermes avant toute participation. Ils exigent la prise en compte explicite de sujets sensibles, notamment le passif humanitaire, l’unité nationale et les problèmes fonciers. Leur réticence illustre le manque de confiance dans la sincérité du processus et fragilise la représentativité globale du dialogue.
Une absence lourde de sens : l’IRA reste à l’écart
L’une des absences les plus significatives est celle de Birame Dah Abeid, leader du mouvement abolitionniste IRA. Ce dernier a publiquement refusé de participer à ce qu’il qualifie d’« énième mascarade politique », dénonçant un simulacre de concertation sans impact réel sur les luttes contre l’esclavage et les discriminations systémiques.
Son absence, combinée à celle d’autres figures influentes de l’opposition négro-africaine, risque de biaisser profondément la nature des débats, notamment sur les thématiques liées à la justice sociale, à l’égalité des droits et à la mémoire nationale. Sans ces voix, le dialogue pourrait perdre toute crédibilité sur les enjeux identitaires et historiques.
Des garanties floues, un scepticisme persistant
Le gouvernement évoque la mise en place de mécanismes de suivi pour appliquer les recommandations issues du dialogue. Mais en l’absence de détails concrets, ces promesses restent largement théoriques. L’histoire politique mauritanienne, marquée par une succession de dialogues sans lendemain, alimente le scepticisme général. Le risque est grand que ce processus se solde, une fois encore, par un rapport de plus rangé dans les tiroirs du pouvoir.
Un outil d’occupation politique ?
Au-delà des intentions affichées, ce dialogue semble aussi répondre à un objectif politique tactique : occuper l’agenda, détourner l’attention des difficultés économiques, et encadrer le débat national autour d’un processus contrôlé. En monopolisant les énergies politiques et médiatiques pendant plusieurs mois, le régime s’offre un répit face à une opinion publique de plus en plus exigeante.
Réforme sincère ou manœuvre dilatoire ?
Le dialogue national aurait pu être une opportunité historique de refondation et de réconciliation. Mais sa réussite dépendra de sa capacité à intégrer toutes les forces vives, à affronter les dossiers les plus sensibles, et à garantir un suivi rigoureux des recommandations.
En l’absence de figures clés comme Birame Dah Abeid, et de représentants légitimes des communautés historiquement marginalisées, le risque est grand que le dialogue se transforme en monologue dirigé, au service d’une stratégie de stabilisation politique plus que d’un projet de transformation nationale.