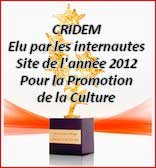04-04-2014 08:00 - Les producteurs de l’Histoire mauritanienne (Suite et Fin)

Adrar Info - Conclusions
La construction de l’histoire en mauritanie l’histoire nationale. C’est en effet autour de l’idée de la possibilité de la construction d’une « histoire totale des peuples » que se sont développés les thèmes historiographiques devenus canoniques en Mauritanie.
Les auteurs coloniaux, notamment le plus prolifique d’entre eux, Paul Marty, se sont attachés à écrire cette histoire en imaginant qu’il existait une sorte d’histoire naturelle déjà là, qu’il fallait simplement coucher par écrit.
Ce faisant, ils ont fabriqué une histoire subjective et restreinte mais non arbitraire car « on ne décrit pas dans l’absolu, toute description implique des choix, inconscients le plus souvent, de traits qui sont décrétés pertinents ». Or, comme je le notais précédemment la chronique d’événements choisie par les auteurs coloniaux « n’est pas la seule manière d’écrire l’histoire, elle est plutôt une solution de paresse » (Veyne 1971 : 60).
L’histoire subjective des auteurs coloniaux a choisi de privilégier la société arabophone bidân, décrétée majoritaire au sein du nouvel Etat‐colonial, comme « représentante » exclusive du « peuple mauritanien ». En effet, la correspondance établie sur le plan politique entre le peuple bidân et le peuple mauritanien, qui relègue dans un second plan les « minorités africaines », fut d’abord fabriquée par la colonisation et par les producteurs coloniaux de l’histoire du pays, et non pas par les premiers gouvernants mauritaniens, comme on a l’habitude de le croire.
Dans cette contribution, j’ai tenté de dégager une confusion conceptuelle récurrente lorsqu’il s’agit de parler d’histoire en Mauritanie — ou ailleurs en Afrique. J’ai ainsi suggéré la coexistence de quatre sortes d’histoire (des lettrés, des colonisateurs, des universitaires et des Mauritaniens) dont le sens est différent selon le cadre de référence.
L’histoire des lettrés ou des érudits bidân renvoie ainsi à des chroniques locales transmises surtout oralement, qui se sont mélangées avec des croyances légendaires. Ce que nous appelons « l’histoire politique » n’a pas suscité un intérêt suffisamment important pour au moins deux raisons : l’inexistence d’un système politique centralisé et dynastique chez les Bidân, et la considération que seule l’histoire de l’islam et de son prophète mérite d’être couchée par écrit.
L’histoire coloniale a pris ces chroniques locales comme sources d’histoire dans le but de construire, par addition d’informations jugées pertinentes, une histoire totale du « peuple maure ». Or en réalité les coloniaux, comme certains universitaires, confondent l’histoire mémorielle avec l’histoire tout court lorsqu’ils tentent de reconstruire le passé. Cette confusion entre la mémoire et l’histoire, entre le récit des hauts faits glorieux du passé qui sert à souder les groupes restreints et le récit des faits qui se sont effectivement passés, et qui peuvent comporter des zones d’ombre, reste d’actualité elle constitue néanmoins un défi qui sera relevé sans nul doute par la nouvelle génération de chercheurs mauritaniens.
Le renouvellement des paradigmes de la recherche fondamentale en Mauritanie se développe ainsi à partir d’une perspective critique et de déconstruction des sources et des discours neo‐coloniaux et neo‐orientalistes qui, en reprenant les mêmes thèmes et les mêmes préjugés du Xxie siècle européen, tentaient encore de se poser, en ce début du Xxle siècle, comme la seule parole d’autorité sur le passé historique des Mauritaniens. Les travaux actuels montrent que les temps ont changé et qu’un vent de renouveau souffle désormais sur les études mauritaniennes.
Mariella Villasante Cervello : “Les producteurs de l’histoire mauritanienne. Malheurs de l’influence coloniale dans la reconstruction du passé des sociétés sahélo-sahariennes », in Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel. Problèmes conceptuels, état des lieux et nouvelles perspectives de recherche (XviiieXxe siècles), M. Villasante (dir.), Vol 1, 2007 : 67-131 ».
Mariella Villasante Cervello
Anthropologue, née à Lima, Pérou. Chercheuse associée au Centre Jacques Berque (Cnrs/Mae, Rabat), à l’Institut français d’études andines (Cnrs/Mae, Lima, et à l’Instituto de democracia y derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Elle a entamé sa formation à l’Universidad Católica del Perú, et effectué ses premiers travaux de terrain chez les Indiens Ashaninka de l’Amazonie péruvienne.
Depuis 1986, elle travaille chez les Bidân de Mauritanie. La partie contemporaine de sa thèse (1995, École des hautes études en sciences sociales) a été publiée sous le titre : Parenté et politique en Mauritanie. Essai d’anthropologie historique. Le devenir contemporain des Ahl Sîdi Mahmud
L’Harmattan, 2007 Cap Vert, Gambie, Libye, Maroc, Mali, Mauritanie,Sénégal]. Ancienne Responsable de la rubrique « Mauritanie » de l’Annuaire de l’Afrique du Nord (1998‐2005), elle écrit des « Chroniques politiques du Pérou »(site web de la Maison des sciences de l’homme, depuis juin 2011) et écrira bientôt des « Chroniques politiques de la Mauritanie » (site web du Centre
M. Villasante a repris ses recherches au Pérou en 2008, ses travaux actuels portent sur la violence politique et les conflits ethniques en Mauritanie et au Pérou. Elle prépare quatre ouvrages, deux sur le Pérou [De la conquête à la guerre interne 1980-2000. Histoire et violence politique au Pérou, 2013 Los Ashaninka y la guerra interna peruana, 2014]. Et deux ouvrages sur la Mauritanie, dont l’un collectif [Histoire et politique dans la région du Fleuve Sénégal, Mauritanie, 2015], et l’autre personnel [Violence politique au Pérou et en Mauritanie, 2016].
Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité